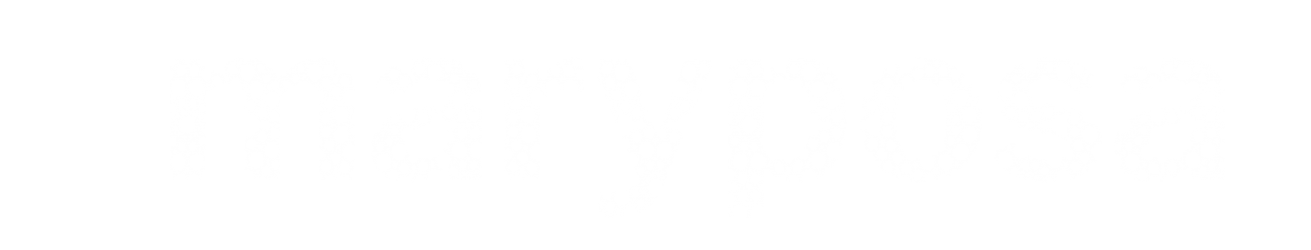Ce stage permet de découvrir des techniques et des rituels simples de méditations basées sur la Pleine Conscience et la Tendresse, afin de mettre plus de présence, de joie et de bonté dans nos vies. Ce stage est ouvert à toutes et tous, sans prérequis de niveaux.
Déroulement et modalités
Le stage comporte un atelier d’une heure trente chaque semaine sur quatre semaines consécutives, puis une journée complète d’intégration un samedi de 9 à 16 heures. Les dates des stages sont précisées sur ce site dès qu’une cession est ouverte.
Pour participer à ce stage, une seule chose compte : notre motivation à mettre plus de présence aimante dans nos vies, pour nous, nos émotions, nos pensées, notre corps, et surtout pour les autres, nos familles, amis, voisins, collègues.
Je suis intéressé
Pour être contacté et participer à notre prochaine cession, laissez nous ici vos coordonnées ;
Réponses aux questions les plus fréquentes
C’est de la méditation de Pleine Conscience ?
Oui, on y pratique des méditations de Pleine Conscience, en insistant sur les deux piliers de la pratique : l’attention et la compassion. On y parle donc d’attention, de non jugement, et on parle aussi de cœur, de tendresse, de pardon, de joie et de bonté.
Est-ce que c’est « spirituel » ?
« Spiritus » en latin veut dire « souffle ». Durant ce stage, on parle souvent de notre respiration, de notre souffle, que l’on choisit parfois d’observer avec tendresse et concentration. Alors oui, étymologiquement, c’est spirituel. Mais c’est aussi une pratique laïque, qui peut tout à fait être pratiquée par une croyante, un agnostique, une bouddhiste, un agnostique, une philosophe, etc.
Pourquoi es-tu « prof de méditation » ?
Je suis Enseignant Chercheur en Sciences Humaines et Sociales, et j’ai découvert la « méditation de pleine conscience » via un ouvrage scientifique « Healing Emotions » en 2003, que j’ai lu à la naissance de mon premier enfant. Je voulais répondre à cette question simple : comment ne pas trop souffrir de mes émotions, de ma colère par exemple, et comment faire en sorte de ne pas refiler trop de casseroles à mes filles…
Après avoir beaucoup lu et médité de façon épisodique, ma pratique est devenue quotidienne depuis 2013. Je fait régulièrement des retraites de méditations et de silence, trois jours, une semaine parfois, dans un cadre bouddhiste comme dans un cadre scientifique et exploratoire (comme celui du Mind & Life Institute). J’ai commencé à enseigner la méditation dans des écoles (collège, Lycée, Enseignement Supérieur) à partir de 2017.
En tant qu’enseignant chercheur, j’ai beaucoup lu et exploré la littérature scientifique consacrée au fonctionnement de notre esprit, de notre système nerveux, aux effets du stress et des croyances sur notre santé, et aussi aux effets bénéfiques des pratiques contemplatives sur notre bien être. Dans mes enseignements, j’essaie toujours de faire le pont entre les connaissances issues des sciences, et celles issues des grands courants de sagesse.
Dans mon propre parcours de méditant, j’ai découvert en moi des trésors, mais aussi des zones désolées. C’est pour cela que je suis particulièrement attiré par des approches de la méditation qui ont du cœur (pratique du pardon, de la joie, de la bonté, de l’humour et de la compassion), parce qu’elles nous aident, non pas à nous changer, mais à nous aimer telles que nous sommes, pour nous accepter et nous guérir. On apprend ainsi à porter un regard tendre sur notre humanité, avec nos hauts et nos bas, nos pensée, nos habitudes, bonnes et mauvaises, nos talents et nos limites.
Depuis 2020, j’ai la chance d’avoir été admis parmi les étudiants de Tara Brach et Jack Kornfield, dans le cadre du programme MMTCP de certification de Professeurs de Méditation, organisé par Greater Good Science Center de l’ University of California à Berkeley. Bien entendu, je suis cet enseignement à distance depuis Hyères les Palmiers en France !